Cancer du col de l’utérus : comment l’éviter ?
10 septembre 2025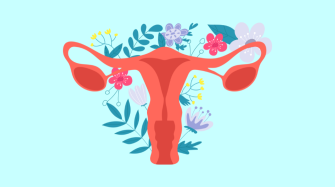
A l’occasion de Septembre Turquoise, mois de sensibilisation au dépistage des cancers gynécologiques, les équipes de gynécologie et d’oncologie HNO reviennent sur l'importance de la prévention et du dépistage du cancer de col l’utérus.
Le cancer du col de l’utérus, c’est quoi ?
Chaque année en France, 3 000 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus sont détectés et 1 100 décès sont enregistrés.
Dans presque 100% des cas, le cancer du col de l’utérus est causé par une infection à papillomavirus humains (HPV). La majorité des hommes et femmes croiseront des papillomavirus humains au cours de leur vie.
La transmission des HPV se fait par contact avec la peau et les muqueuses, le plus souvent lors de rapports sexuels, avec ou sans pénétration. C’est pourquoi le préservatif, s’il permet de limiter le contact avec le virus, ne peut toutefois pas assurer une protection complète.
Le HPV va alors entraîner des lésions au niveau du col de l’utérus. Le plus souvent, ces lésions sont indolores et guérissent par elles-mêmes. Mais dans 10% des cas, le virus persiste au niveau de la muqueuse du col utérin, des cellules anormales apparaissent et les lésions évoluent en cancer. Cette évolution peut prendre 10 à 15 ans et ne génère aucun symptôme.
C’est pourquoi les deux actions de prévention menées en France sont complémentaires :
- La vaccination contre les HPV, recommandée chez les filles et les garçons à partir de 11 ans,
- Et le suivi régulier avec frottis pour dépister le cancer du col de l’utérus le plus tôt possible.
Pourquoi se faire vacciner contre les HPV ?
La vaccination anti-HPV est l’un des piliers de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. En effet, si la vaccination est faite jeune, alors son efficacité contre l’infection par les principaux HPV est proche de 100%. Le vaccin contient 9 types de HPV, dont 7 responsables de 90% des cancers du col de l’utérus.
Le nombre de jeunes vaccinés est en progression, mais est encore insuffisant.
On pense à tort que la vaccination contre les HPV ne protège que les femmes du cancer du col de l’utérus. En fait, le vaccin protège aussi les hommes contre des cancers dus aux HPV : cancer du pénis, cancer oropharyngés (bouche, gorge…), cancer de l’anus… Le vaccin protège aussi des verrues génitales et ce, quel que soit le sexe.
Ainsi, le vaccin est recommandé et remboursé par la Sécurité Sociale pour les jeunes filles et garçons entre 11 et 14 ans, avec un rattrapage possible jusqu’aux 25 ans du jeune adulte.
Des études sont en cours pour mesurer l’efficacité d’une vaccination au décours d'un traitement contre une des lésions précancéreuses du col. Selon les premiers résultats cette vaccination semble peu ou pas efficace lorsque la pathologie liée à l'HPV est déjà présente ; c'est pourquoi la vaccination préventive suffisamment tôt chez l'adolescent voire le jeune adulte est essentielle pour une bonne protection.
En quoi consiste le dépistage ?
En France, le dépistage du cancer du col de l’utérus est organisé à l’échelle nationale et pris en charge pour chaque femme de 25 à 65 ans.
Le dépistage régulier permet de détecter les lésions précancéreuses et le cancer à un stade précoce, offrant ainsi de meilleures chances de traitement et de guérison.
Dans l’Ain et dans le Rhône, 64% et 69% des femmes ont participé au dépistage entre 2020 et 2022 (selon Santé publique France). Si ces 2 départements font partie des bons élèves, nous sommes encore loin de l’objectif des 80%.
Globalement si tout va bien, les femmes sont invitées à se rendre chez leur gynécologue, médecin généraliste ou sage-femme pour réaliser un frottis tous les 3 ans entre 25 et 30 ans, puis tous les 5 ans entre 30 et 65 ans.
Et si on est vaccinée contre les HPV ?
Le vaccin contre les HPV protège contre 9 HPV, dont 7 connus pour être responsables des cancers du col de l’utérus. Mais il en existe beaucoup d’autres… C’est pourquoi le dépistage régulier est indispensable, même si l’on est vaccinée.
Que faire si le dépistage indique la présence d’un HPV ?
Tout d’abord, si le test de dépistage indique la présence de HPV, cela ne signifie pas nécessairement que c’est un cancer. Il peut s’agir, par exemple, d’une infection récente, qui guérira par elle-même.
Un test complémentaire sera alors réalisé, sur la base du même prélèvement. Cette analyse cytologique permet d’observer la forme des cellules du col utérin. Si les cellules ont une forme anormale, une colposcopie est alors indiquée afin :
- d’observer le vagin et le col de l’utérus à l’aide d’un colposcope
- et de faire des prélèvements de tissus pour être ensuite analysés par notre laboratoire.
Conscients de l’inquiétude générée par la réception d’un test positif, nos gynécologues proposent des rendez-vous avec des délais limités pour réaliser les colposcopies.
Une consultation de colposcopie ressemble énormément à un examen gynécologique classique. Elle est simplement un peu plus longue pour nous permettre de déceler d’éventuelles anomalies.
Une fois les résultats de biopsie reçus, un nouveau rendez-vous sera proposé à la patiente pour échanger sur le diagnostic.
Les signes d’alertes
Le cancer du col de l’utérus se développe lentement et sans douleurs.
Mais à un stade plus avancé, il peut engendrer plusieurs signes non spécifiques :
- des saignements après les rapports sexuels et/ou dehors des périodes de règles
- des douleurs pendant les rapports sexuels ;
- des pertes vaginales anormales, plus abondantes ou malodorantes
- des difficultés à uriner ou pour aller à la selle
- des douleurs lombaires…
Ces symptômes peuvent aussi avoir d’autres causes.
En cas de doute, il est important de les signaler à votre médecin afin qu’il en détermine l’origine.


